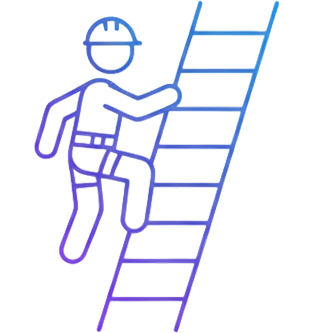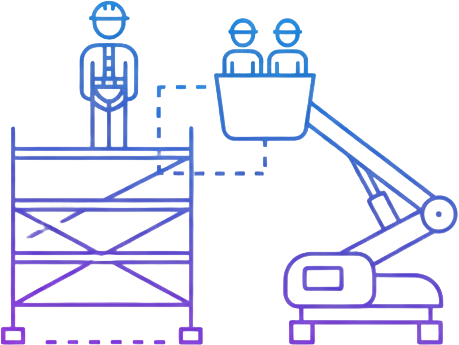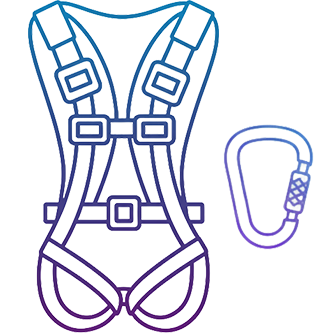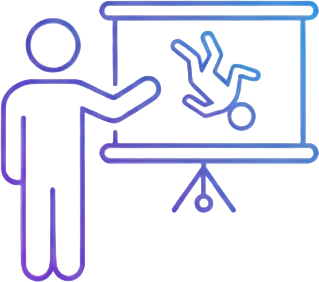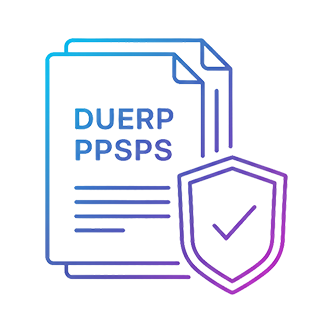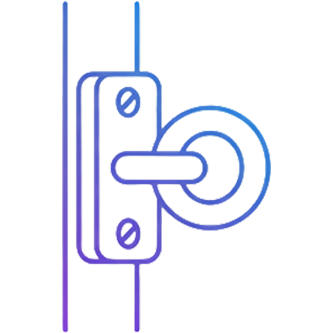Réglementation du travail en hauteur
Réglementation du travail en hauteur
obligations,normes et prévention
obligations,normes et prévention
Cadre légal : obligations et prévention
Travailler en hauteur expose à un risque majeur : la chute. Le Code du travail encadre strictement cette activité et fixe des règles claires pour protéger les salariés et responsabiliser les employeurs
Obligation générale de sécurité
L’employeur doit garantir la santé et la sécurité des salariés (Code du travail, art. L.4121-1 et L.4121-2).
Cela implique :
- Anticiper les risques liés aux chutes de hauteur,
- Mettre en place des protections adaptées,
-
Informer et former les travailleurs.
Quand parle-t-on de travail en hauteur ?
Il n’existe pas de seuil unique de hauteur. Ce qui compte, c’est l’existence d’un risque de chute susceptible de porter atteinte à la santé ou la sécurité d’un salarié.
Priorité aux protections collectives
Les protections collectives (garde-corps, filets, nacelles sécurisées, échafaudages…) doivent être mises en place en premier.
Les équipements de protection individuelle (EPI) n’interviennent qu’en cas d’impossibilité technique ou d’efficacité insuffisante des EPC.
Les principes généraux de prévention
La réglementation s’appuie sur neuf principes. Les plus structurants pour le travail en hauteur sont :
Travaux temporaires en hauteur : obligations de l’employeur

Principes essentiels à retenir
L’objectif est de limiter au maximum le risque de chute, en donnant la priorité aux protections collectives et en ne recourant aux équipements de protection individuelle (EPI) qu’en dernier ressort.
-
Plan de travail adapté :
Tout poste doit être stable, résistant et dimensionné pour assurer la sécurité des opérateurs (art. R.4323-58).
-
Garde-corps en priorité :
Lorsqu’il existe un risque de chute, des protections collectives doivent être installées en premier lieu (art. R.4323-59).
-
Usage des EPI uniquement si nécessaire :
Le recours aux harnais, longes, antichutes ou cordes n’est possible que si aucune protection collective n’est réalisable. Dans ce cas, l’opérateur ne doit jamais intervenir seul (art. R.4323-61).
-
Équipements adaptés :
Le choix des matériels doit être cohérent avec la tâche et les risques identifiés (art. R.4323-62 ; normes EN 361 harnais, EN 355 absorbeurs, EN 795 ancrages, etc.
En pratique
Pour l’employeur, ces obligations impliquent :
- Une évaluation préalable des risques (DUERP),
- La mise en place de procédures de prévention adaptées,
- La formation spécifique des salariés au port et à l’utilisation des EPI antichute (FD S71-521),
- Et le contrôle régulier des équipements.
Accès et postes de travail
La réglementation impose que les moyens d’accès et les postes de travail en hauteur garantissent en toutes circonstances stabilité et sécurité.
À retenir
- Les échelles et escabeaux sont limités aux interventions brèves et ponctuelles.
- Les échafaudages et PEMP sont les solutions à privilégier pour les travaux temporaires.
- Les protections permanentes (garde-corps, ancrages fixes) doivent être intégrées dès la conception des ouvrages.
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne sont pas des postes de travail permanents. Leur usage doit rester exceptionnel :
- interventions de très courte durée,
- travaux ponctuels non répétitifs,
- faible exposition au risque de chute.
Dès que l’intervention est prolongée ou répétée, ces équipements doivent être remplacés par des solutions plus sûres.
Pour les situations nécessitant stabilité et liberté de mouvement, la réglementation et les bonnes pratiques imposent de privilégier :
- Échafaudages (fixes ou roulants) conformes et vérifiés,
- Plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) pour les accès temporaires,
- Plateformes individuelles roulantes (PIR) et plateformes individuelles roulantes légères (PIRL) pour les interventions courtes mais répétées,
- Garde-corps, passerelles et planchers sécurisés intégrés dès la conception des ouvrages,
- Points d’ancrage permanents quand des interventions régulières sont prévues.
Ces équipements assurent une protection collective et réduisent la dépendance aux EPI. Ils doivent être installés, utilisés et contrôlés conformément aux normes applicables (EN 12811 pour les échafaudages, EN 280 pour les PEMP, EN 795 pour les ancrages).
Réglementation EPI antichute
Équipements de protection individuelle contre les chutes
Les EPI antichute s’utilisent uniquement en dernier recours, quand les protections collectives (échafaudages, garde-corps, PEMP…) ne peuvent pas être mises en place. Leur usage nécessite une évaluation des risques, une formation adaptée et une vérification annuelle obligatoire.
À retenir
- Les EPI sont le dernier recours après les protections collectives.
- Ils doivent être conformes aux normes européennes.
- Une vérification annuelle avec traçabilité est obligatoire.
Réglementation – formation EPI obligatoire
Formation obligatoire à l’utilisation des EPI antichute
Tout salarié appelé à utiliser un harnais ou tout autre équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur doit obligatoirement suivre une formation pratique à leur usage et aux procédures de secours. Cette exigence est inscrite dans le Code du travail (articles R.4323-104 et R.4323-106) et précisée par la recommandation FD S71-521 (AFNOR, 2020).
La formation doit être adaptée aux situations de travail et renouvelée régulièrement

Contenu et durée des formations EPI antichute
Selon les recommandations de la FD S71-521
Module
initial
Théorie (réglementation, risques, systèmes antichute) + Pratique (port et réglage du harnais, contrôle EPI, déplacements, ancrages)
Maintien
Retenue
Positionnement au poste de travail, longes de maintien, points d’ancrage complémentaires
Accès spécifiques
Progression sur structures (pylônes, toitures, talus, sites non équipés…)
Évacuation
équipier
Procédure de secours d’un équipier en difficulté (simple ou complexe selon scénario)
Maintien des Compétences
Actualisation des pratiques, recyclage sécurité et EPI
Réglementation – documents obligatoires
Organisation et documents obligatoires
La prévention du risque de chute en hauteur ne repose pas seulement sur les équipements ou la formation : elle doit être formalisée par des documents réglementaires que l’employeur est tenu de mettre en place. Ces écrits assurent la traçabilité des mesures de sécurité et facilitent le contrôle par les autorités compétentes.
Documents à établir ou tenir à jour
DUERP
entreprise.
Le Document Unique d’Évaluation des Risques est l'iInventaire des risques professionnels, dont les chutes de hauteur. Mise à jour régulière et communication aux salariés.
Plan de prévention
Mesures de sécurité à appliquer lors d’une coactivité (entreprise extérieure / donneur d’ordre). Inspection préalable obligatoire.
PPSPS / PGCSPS
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, intégré au Plan Général SPS. Couvre organisation, moyens, responsabilités.
Registre EPI
Suivi des contrôles périodiques (au moins 1 fois/an) des harnais, longes, connecteurs, antichutes.
Ces documents structurent l’organisation de la prévention du risque de chute en hauteur. Ils s’ajoutent à la formation et à l’utilisation des EPI, et relèvent directement de la responsabilité de l’employeur.
Réglementation – lignes de vie et ancrages
Lignes de vie et ancrages
Les dispositifs d’ancrage et les lignes de vie constituent un maillon essentiel de la protection individuelle contre les chutes de hauteur. Leur installation, leur contrôle et leur utilisation sont strictement encadrés par les normes européennes et le Code du travail.
Exigences principales
L’application de ces normes, et en particulier de la nouvelle EN 17235, exige une vigilance accrue lors de l’étude, de l’installation et de la vérification des ancrages permanents. L’employeur en reste directement responsable.
- EN 795 : dispositifs d’ancrage (temporaire et permanent)
- EN 353-1 / EN 353-2 : antichutes mobiles sur support rigide ou flexible
- CEN/TS 16415 : recommandations pour dispositifs d’ancrage utilisés simultanément par plusieurs personnes
- EN 17235 (2024) : dispositifs et systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure.
➝ Introduit des classes de résistance adaptées de 1 à 4 utilisateurs et renforce la traçabilité des installations.
- Contrôle initial avant mise en service
- Vérification annuelle par une personne compétente
- Contrôle immédiat après toute chute ou incident
- Registre de sécurité
- Notice du fabricant
- Date de mise en service
- Résultats des contrôles conservés